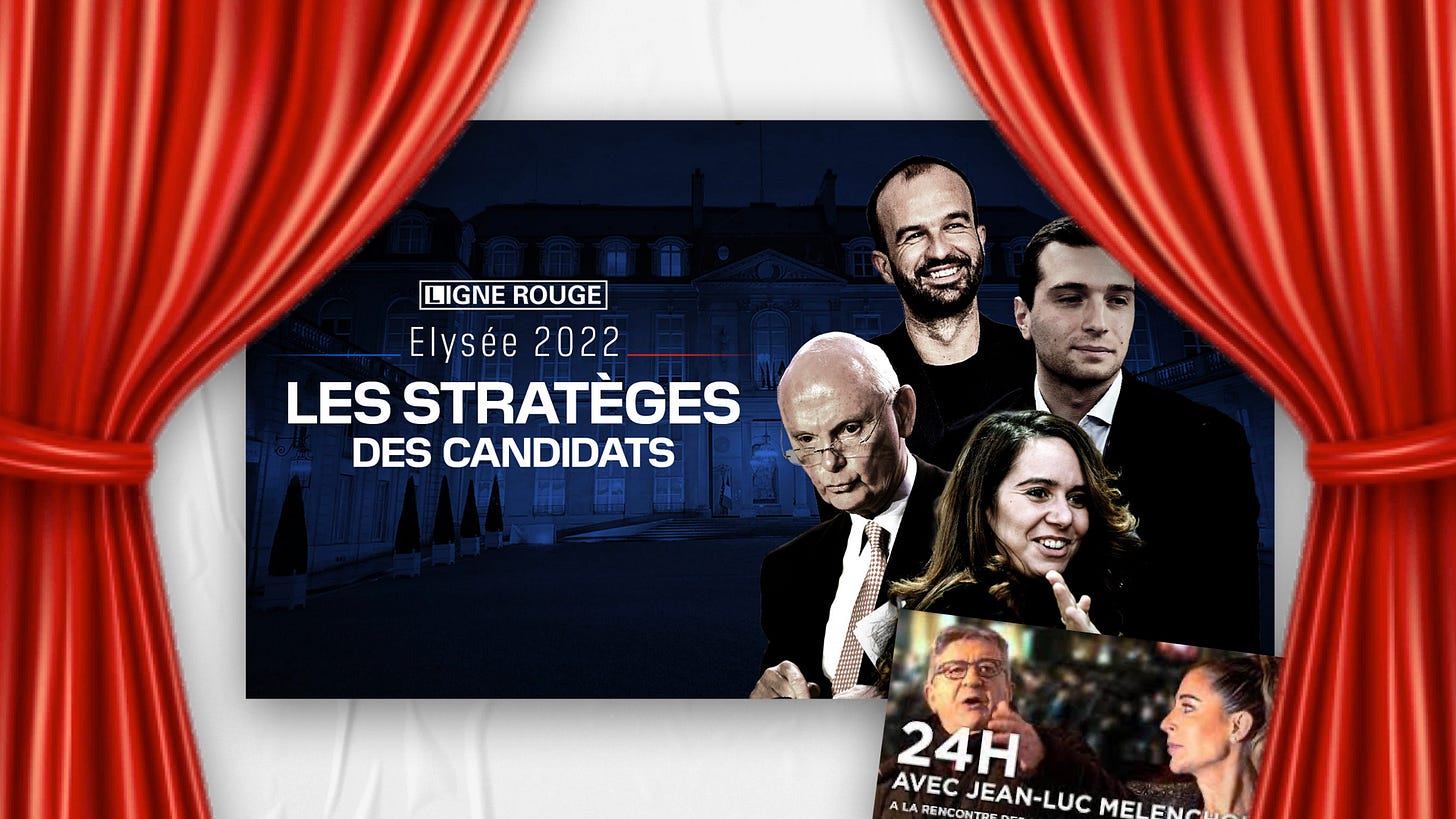Aura ou aura pas ses parrainages ? Quand le président va-t-il se porter candidat ? Parle-t-on de vrais sujets pour les Français ? A quand l’union de la gauche ?
Cette campagne présidentielle ne ressemble à aucune autre et pourtant elle est tellement semblable à celles qui l’ont précédée.
La seule certitude ? Tout se jouera, comme d’habitude, au dernier moment. Mais en attendant on s’est dit qu’on allait continuer de faire ce qu’on aime faire avec vous et pour vous : analyser, décrypter, aller plus loin... Avec les différents regards de nos expertises de com, pour vous proposer de lire ici des choses que vous ne lirez pas ailleurs, sans poudre aux yeux.
Meeting > Meetic
En 2022, les meetings politiques continuent de jouer un rôle prépondérant dans la construction d’une personnalité politique en soulignant le caractère extra-ordinaire d’une femme ou d’un homme (d’où le titre si vous avez suivi). Pas étonnant donc que l’équipe de Valérie Pécresse ait autant fait de teasing sur son grand meeting qui devait constituer un tournant dans sa campagne. Un tournant, cela l'aura bien été. Sur les réseaux sociaux où la moquerie est un art, Valérie Pécresse est désormais un mème.
Penser un meeting en 2022 sans penser à sa résonance digitale est incontestablement une erreur. Si le risque pourrait être de prendre des tweets d'anonymes sérieusement, une vague d'entre eux démontre cependant une tendance de ce qui se voit, plus encore que de ce qui s’est dit. Ces meetings sont devenus des réservoirs à mèmes, signant une relative victoire de la forme sur le fond. Car peu importe ce que diront ces vidéos, le capital humoristique prévaudra toujours. Cette transformation du propos est incontrôlable, obscurcit deux heures de meeting réduites en séquences burlesques de 12 secondes.
En 2017, Emmanuel Macron avait été le candidat moqué mais victorieux du « Parce que c'est votre projet » et Jean-Luc Mélenchon, le candidat à l’hologramme. Un nouveau pan de la communication politique s'ouvre désormais : chaque séquence devant être réfléchie hors de son contexte, pour l’image qu’elle renvoie et sa potentielle viralité. Une tâche ardue d’autant que l’humour reste une science inexacte.
Le symbole du monarque à la voix de ténor ayant perdu de sa superbe, la quête de figures statutaires reste donc le travail obligé des candidats. Si une photo aux côtés d’un ancien Premier ministre est toujours une image forte, le pari peut être aujourd’hui, comme le fait Jean-Luc Mélenchon sur TikTok, de prendre à contre-courant cette tendance en s’y inscrivant directement. Mais malgré toutes les stratégies tactiques, l’imprévu a le goût de l’efficace pour une génération lassée des mots tout autant que des images.
Par Naomi Philippe et Hugo de Choisy
Le mot de la semaine : roussellement
« Ce qui coûte cher, c’est sa théorie du ruissellement. Et bien moi je vous propose une autre théorie : le « roussellement ». Ça va faire jaser ça. […] Avec le « roussellement », quand on donne 300€ à un salarié, il ne les dépense pas dans les paradis fiscaux. Il les dépense pour la France » (Fabien Roussel à son meeting de Marseille, 6 février 2022).
Le mot est lancé, la campagne aussi. Néologisme inspiré d’une théorie bien connue et défendue par le Président de la République, le « roussellement » incarne la construction médiatique et l’image que souhaite se donner Fabien Roussel pour cette campagne présidentielle.
Parce que le « roussellement », dans la définition qu’en donne le candidat, ce n’est rien d’autre que le multiplicateur keynésien présenté dans la Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie de l’économiste bien connu. L’État investit dans les ménages qui ont la plus forte propension à consommer pour relancer l’économie, par un effet multiplicateur. Une théorie depuis longtemps populaire à gauche.
Et derrière le mot inventé « roussellement » ce n’est rien d’autre qu’un des fondamentaux de la gauche que revendique le candidat. Seulement, Fabien Roussel redonne un lustre nouveau dans les mots d’un parti porteur d’une image historique - qu’elle soit positive ou négative selon où vous vous placez – voilà ce que réussit le candidat. C’est d’ailleurs sa marque de fabrique et sa construction médiatique. Le slogan de la campagne en est la preuve : « La France des jours heureux ». Fabien Roussel prône le bien-être, la « France Label Rouge », le « droit au bonheur »… C’est un vent de fraîcheur bienvenu pour le parti de Georges Marchais, mais attention, à force de trop faire ruisseler les mots, de ne pas s’y noyer.
Par Justin Dérobert
Dans tes rêves ?
Quand le droit décrypte la com (et vice et versa)
Regard sur des propositions en rupture avec nos grands textes et principes. Cette semaine, focus sur certaines propositions de Valérie Pécresse.
1. Ouvrir des « centres correctionnels fermés » et « en finir avec l’aménagement des courtes peines »
« Dès l’été, nous reconvertirons des bâtiments désaffectés en centres de détention pour les caïds sous bracelet électronique. ».
La loi oblige les tribunaux à adapter les peines à la personnalité, la situation familiale et la situation professionnelle des condamnés, dans un objectif de réinsertion, et la détention à domicile en fait partie. Comment refuser l’aménagement des peines alors que le principe d’une peine individualisée figure dans l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dont les droits et principes ont pleine valeur constitutionnelle ?
2. « Territorialiser » les peines
« Commettre une peine (sic) dans un lieu dans lequel on en commet beaucoup trop pourrait être une circonstance aggravante »
Punir plus sévèrement un vol à la tire commis dans un hyper de Seine-Saint-Denis plutôt que sur un marché de Périgueux ? Pourquoi ? Sur quel fondement ? Le principe d’égalité de tous les citoyens devant la loi, qui figure dans l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – et a donc valeur constitutionnelle - semble prévenir sans équivoque ce type d’initiative.
3. « Limiter le pouvoir législatif du gouvernement et le pouvoir d’amendement du parlement »
Selon Le Monde, la candidate souhaite « limiter le pouvoir législatif du gouvernement et le pouvoir d’amendement du parlement » pour « éviter que la loi ne rentre dans des détails ».
Difficile de voir comment, et surtout au nom de quoi, l’on pourrait défendre aux assemblées de se livrer à leur activité favorite - le droit d’amendement - consacrée par la Constitution (article 44).
4. « Abaisser la majorité pénale à 16 ans »
« Nous voulons en particulier renforcer la réponse pénale et à l’adapter à la réalité de la délinquance »
Est-on toujours un enfant à 17 et 11 mois ? Peut-on être jugé comme et avec des adultes à 16 ans ? La mise en place d’une justice spécifique pour les mineurs est un principe essentiel de la Convention internationale relative aux droits de l’Enfant (article 40), ratifiée par la France en 1990. La responsabilité pénale des mineurs en fonction de leur âge est par ailleurs un principe à valeur constitutionnelle (décision du Conseil constitutionnel de 2002). « Abaisser la majorité pénale » semble difficilement conciliable avec cet impératif.
Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau candidat et de nouvelles propositions !
Par Rachel Tort et Alexis Madelain
Le docu politique, nouveau tract de campagne ?
Le récit politique se nourrit aussi de documentaires, censés démystifier la construction des symboles et les coulisses de la mise en scène du pouvoir. Ces formats longs, hérités d’Une partie de campagne de Raymond Depardon (1974) ou de Paris à tout prix d’Yves Jeuland (2001) se multiplient désormais… jusque sur les chaines d’info en continu !
Deux tendances à relever en matière de communication :
1. La mise en scène des coulisses, mise en abyme du récit politique
Si les campagnes sont une pièce de théâtre faite de mises en scène, les coulisses font à leur tour partie de la pièce. Les candidats semblent porter une attention croissante au genre : Livre Noir, le média d’extrême-droite porté par des proches de Marion Maréchal-Le Pen suit la campagne d’Éric Zemmour au quotidien, quand Magali Berdah, plus proche de la téléréalité que de L'Emission politique, s'invite en immersion dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon . Les spin doctors semblent avoir bien compris la puissance narrative de ces formats, bien inspirés par la résonance de documentaires à la Netflix, à l’image de la série Formula 1 Drive To Survive qui a totalement transformé l’image de ce sport et recruté des millions de fans. Déjà, en 2017, pour Les coulisses d’une victoire, l’équipe d’Emmanuel Macron avait veillé à « embedder » un journaliste pour des images en parfaite osmose avec le récit de la campagne : jeunesse, bienveillance, disruption. Critiqué, ce documentaire est resté culte par des séquences marquantes.
2. Les communicants, de l’ombre à la lumière
Le rôle de Sarah Knafo dans la campagne d’Éric Zemmour est emblématique : à la fois stratège, communicante, et compagne du candidat d’extrême droite, elle apparait systématiquement sur les images (ici sur BFMTV), tout comme son communicant numérique Samuel Laffont qui donne même les clés de la stratégie dans une interview au Monde ! Déjà, en 2013, Gaspard Gantzer était très visible dans le documentaire Le Pouvoir, d’Yves Jeuland. Cette visibilité ne va pas de soi : elle va plutôt à l’encontre d’une tradition de discrétion très marquée chez Jacques Pilhan, le communicant de François Mitterrand et Jacques Chirac. Il faut relire les phrases de François Bazin dans la géniale biographie qu’il lui a consacrée, Le sorcier de l’Élysée : “Ne pas être vu. C’était pour lui une règle de vie. C’était, désormais, une obsession”. Une époque qui semble bel et bien révolue.
Par François d’Estais
Com’ de campagne ou publicité ? Le révélateur Tinder
Les candidats aux élections peuvent-ils se comporter comme les marques en communication ? Slogan, storytelling, symboles… Les échanges de bonnes pratiques entre publicité et communication de campagne semblent aussi vieux que les compétitions électorales. Mais à l’ère des nouveaux médias, les frontières se sont-elles brouillées ? L’usage récent de Tinder lors de la Saint-Valentin montre qu’au contraire, en fait de zone grise, la démarcation demeure claire au moins sur le terrain de la publicité.
Ce 14 février, les Jeunes & Jadot ont ainsi lancé de faux profils sponsorisés à l’effigie de leur candidat favori sur les principales applications de rencontre. Faisant respecter ses conditions d’utilisation, Tinder a logiquement imposé aux militants EELV de retirer la sponsorisation payante du profil qui, outre les règles propres à la plateforme, enfreignait aussi et surtout l’interdiction de la publicité politique durant les 6 mois précédant une élection. Une disposition du code électoral qui en décembre dernier avait d’ailleurs aussi conduit Facebook à désactiver des posts sponsorisés de Reconquête, le parti d’Éric Zemmour.
Mais plus ambiguë s’est avérée l’initiative des Jeunes Avec Macron (JAM) pour cette même fête des amoureux. Dans un dispositif similaire, ce bras armé du parti présidentiel a créé des profils Tinder, Bumble et Grindr invitant à s’inscrire sur les listes électorales avant la date butoir du 4 mars : « Viens matcher avec la démocratie ! », apostrophaient-ils ainsi les « swipers ». En dépit de ce message supposément transpartisan, incitant au devoir citoyen sans donner de consigne de vote explicite, Tinder a prononcé une mise au ban identique.
Pourtant, quelques jours plus tôt, l’ONG A Voté avait profité des mêmes espaces de communication de Tinder dans un but analogue : médiatiser un chatbot WhatsApp / Ouest-France capable lutter contre la mal-inscription électorale – première cause d’abstention chez les jeunes – en les guidant dans leurs démarches administratives. À objectif identique, une ONG a ainsi pu communiquer là où une entité engagée dans la compétition électorale a été bloquée, en conformité avec le cadre légal en vigueur. D’où une leçon pour les JAM : au moment de rappeler certaines fonctions démocratiques, l’auteur d’un message publicitaire compte plus que son contenu en période électorale – ou l’art de savoir bien se situer dans le débat public.
Par Clément Reuland